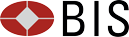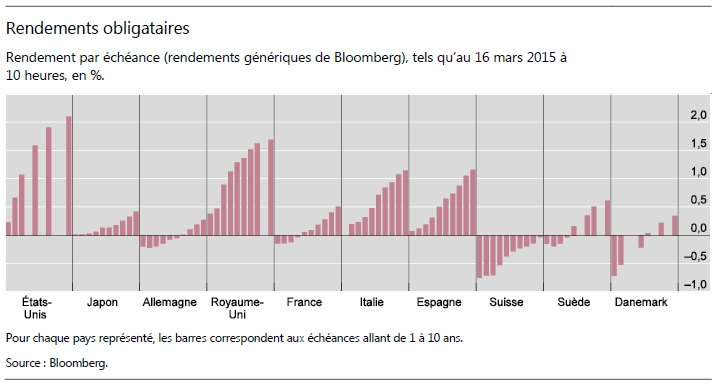Rapport trimestriel BRI, mars 2015 - commentaires à la presse
Veuillez noter que les opinions exprimées dans les études sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la BRI. Lorsque vous mentionnez ces études, nous vous remercions de citer les auteurs et non la BRI.
Présentation officielle par Claudio Borio, Chef du Département monétaire et économique de la BRI, et Hyun Song Shin, Conseiller économique et Chef de la recherche, le 16 mars 2015.
Comme on peut l'observer sur les marchés obligataires jour après jour, les limites de l'impensable sont extraordinairement extensibles. Fin février, l'équivalent de $2 400 milliards de titres de dette souveraine de long terme se négociaient pour un rendement négatif. Sur ce total, l'équivalent de $1 900 milliards avaient été émis par des emprunteurs de la zone euro. Depuis, la trajectoire descendante des rendements ne s'est pas démentie : les derniers chiffres indiquent que, pour les dettes souveraines française, allemande et suisse, ils restent négatifs jusqu'à quatre, six et dix ans, respectivement.
Dans Les Aventures de Tom Sawyer, Mark Twain nous livre le secret d'une bonne affaire : faire repeindre la clôture par ses amis et, de surcroît, leur faire payer ce privilège. À cette aune-là, certains emprunteurs souverains font bien mieux.
Il n'est guère difficile de comprendre la cause immédiate de cette situation sans précédent. Depuis un certain temps déjà, soucieuses de s'acquitter de leurs missions, en particulier s'agissant d'inflation, les banques centrales mènent des politiques d'assouplissement résolues. C'est la BCE qui, récemment, s'est montrée la plus offensive, en annonçant un programme étendu d'achat d'actifs, dont l'ampleur et la durée indéterminée ont surpris les marchés. Depuis début décembre, une vingtaine d'autres banques centrales ont adopté, elles aussi, des mesures d'assouplissement, prenant, à leur tour, les marchés par surprise : certaines, comme la Banque populaire de Chine et la Banque de réserve de l'Inde, essentiellement pour s'adapter à des conditions intérieures, tandis que d'autres, comme la Banque nationale suisse et la Banque centrale du Danemark, en réaction à des conditions extérieures, leurs cours de change respectifs subissant - ou risquant de subir - d'énormes pressions. Disons, plus généralement, que compte tenu du fort degré d'intégration des marchés financiers, même la flexibilité du cours de change n'a un rôle d'isolant que limité. Rappelons que le rendement à trois mois du droit de tirage spécial, panier regroupant les principales monnaies aux fins des réserves de change, est inférieur à 5 points de base. Dans pareil environnement, l'assouplissement appelle l'assouplissement.
Ce faisant, les banques centrales ont fait apparaître que le « plancher du taux zéro » sur les taux d'intérêt nominaux était, pour le moins, poreux. Des taux directeurs négatifs, parfois associés à des achats étendus d'actifs à long terme, ont résolument poussé plus loin encore en territoire négatif les primes d'échéance et les rendements nominaux. Si cette aventure inédite perdure, des limites techniques, économiques, juridiques et même politiques risquent bien d'être atteintes. Il conviendra d'en suivre de près les conséquences, car les répercussions ne manqueront pas de peser sur le système financier et au-delà.
La conjonction de taux d'intérêt négatifs et d'achats étendus d'actifs dans la zone euro explique, en partie, un autre phénomène sans précédent : ces derniers mois, le niveau des rendements obligataires dans la zone euro a influé significativement sur celui des rendements équivalents aux États-Unis. Après les annonces de la BCE, le rendement du Bund allemand a perdu 13 points de base, et les bons du Trésor américain, par moins de 9 pb.
Des taux si bas expriment, autant qu'ils renforcent, deux autres grands déterminants du paysage financier. La faiblesse des taux résulte, en effet, en partie, de la vive baisse des cours du pétrole. Celle-ci, conjuguée à une diminution moins importante du cours d'autres produits de base, a accentué les pressions désinflationnistes à court terme. Mais, la faiblesse des taux a aussi contribué à renforcer l'appréciation du dollar, dans un contexte disparate s'agissant des situations monétaires, actuelles et anticipées, et des perspectives macroéconomiques. Le cours du dollar pondéré en fonction des échanges commerciaux s'est apprécié de pas moins de quelque 20% depuis mi 2014, l'une des plus vives hausses jamais enregistrée sur une période équivalente. Dans le même temps, la dépréciation de l'euro face au dollar s'est accélérée, s'approchant d'une parité 1:1.
Qu'est-ce que cela signifie pour les conditions financières internationales actuelles - autrement dit, la « liquidité mondiale » ? L'euro et le yen peuvent-ils endosser une partie du rôle central du dollar dans cette offre de liquidité mondiale ? Peut-être, mais jusqu'à un certain point seulement. Le dollar reste la principale monnaie de libellé pour le commerce international, ce qui crée une demande structurelle pour cette monnaie. Toutefois, quoi qu'il en soit des évolutions futures, l'encours a un impact primordial sur les conditions de financement, les variations du cours de change et des taux d'intérêt allégeant ou alourdissant le poids de la dette déjà contractée. Sur ce terrain-là, le dollar reste prédominant, avec plus de $9 000 milliards d'encours au secteur non bancaire hors des États-Unis ; loin derrière, l'euro occupe la deuxième place, avec $2 300 milliards, essentiellement aux confins de la zone euro. En ce sens, une nouvelle appréciation du dollar, en particulier si elle va de pair avec un durcissement de la politique monétaire des États-Unis, aura, globalement, tendance à resserrer les conditions financières internationales.
Parallèlement, des vulnérabilités se développent lentement, sous l'effet d'une forte croissance du crédit dans plusieurs pays moins touchés par la crise. À compter de ce numéro, le Rapport trimestriel, suivra divers indicateurs de liquidité mondiale, et les analysera, plus largement, dans le contexte de l'évolution financière intérieure1. À ce jour, ces statistiques ou indicateurs mettent en évidence plusieurs tendances : la contraction après la crise du crédit bancaire international au niveau mondial suite à son expansion d'avant la crise, essentiellement due à un amenuisement des flux entre pays avancés ; la poursuite de la forte expansion du crédit international dans certaines EME, dépassant parfois la croissance du crédit intérieur ; la forte augmentation du crédit en dollar dans ces économies ; le déplacement des sources de financement vers les marchés des capitaux ; et les signes, il est vrai toujours peu clairs, de la formation de déséquilibres financiers intérieurs.
Au final, l'état de la liquidité mondiale a renforcé l'état de la liquidité nationale. Soulignons que les dernières données montrent que l'expansion financière dans certaines EME a commencé de s'essouffler. En particulier, la croissance des créances des banques déclarantes BRI sur la Chine s'est fortement ralentie : elle atteignait seulement 3 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2014. Et même les prêts interbancaires se sont contractés. Il faudra suivre attentivement l'éventuel basculement des cycles financiers intérieurs qui pourrait intervenir avec le durcissement prévisible des conditions de financement en dollar.
Dans ce contexte, la quête de rendement n'a pas disparu, pas plus que la dépendance des marchés à l'égard des mesures d'assouplissement monétaire mises en œuvre par les banques centrales. Les derniers signes de nervosité des marchés après la publication d'un chiffre de l'emploi élevé aux États-Unis - qui peut laisser supposer un relèvement des taux directeurs à bref délai - n'en sont que le dernier exemple. La volatilité a retrouvé ses moyennes historiques, signe d'une prise de risque moins agressive. Avec une voie de sortie qui se rétrécit depuis si longtemps, il n'est pas possible que les marchés demeurent liquides. Aucune illusion n'est permise à ce sujet.
Je laisse la parole à mon collègue Hyun Shin, qui va maintenant développer certains de ces points.
Hyun Shin
Permettez-moi maintenant d'aborder le contenu des études présentées dans ce Rapport trimestriel BRI.
Nous nous sommes efforcés, comme toujours, de publier des articles sur des sujets pouvant éclairer certaines questions d'actualité.
Nous avons retenu les sujets suivants :
- les coûts économiques de la déflation ;
- l'évolution de l'investissement après la crise financière ;
- le rôle de la dette dans la récente chute des prix pétroliers ;
- les conséquences de l'inclusion financière sur les politiques des banques centrales ;
- et la liquidité de marché.
Notre temps à tous étant limité, mon commentaire ne portera que sur trois de ces cinq études.
La première, sur les coûts économiques de la déflation, est signée Claudio Borio, Magdalena Erdem, Andrew Filardo et Boris Hofmann. Ses auteurs y font une analyse historique de la relation entre déflation et croissance de la production.
La récente chute du cours du pétrole et d'autres produits de base a fait baisser, parfois jusqu'en territoire négatif, les taux d'inflation IPC partout dans le monde. En janvier, l'inflation IPC annuelle enregistrait des valeurs à peine positives dans les économies avancées et inférieures à 3 % dans les économies émergentes.
Les données historiques analysées dans l'étude donnent matière à réfléchir.
Premièrement, la déflation, définie de façon simple comme la baisse du prix des biens et services, est un phénomène relativement courant depuis le début de la période étudiée, à savoir 1870. Dans les 38 économies de l'échantillon, les épisodes de déflation représentent une durée cumulée équivalant à environ 18 % de la période totale. Ces épisodes sont cependant devenus plus rares et plus brefs après la Seconde Guerre mondiale.
Deuxièmement, objet d'un débat récurrent, le terme "déflation" évoque souvent la Grande dépression, et notamment l'effondrement de la production et un chômage de masse. Or, les données historiques donnent à penser que la Grande dépression a constitué une exception à la règle. La croissance moyenne y était, de fait, plus élevée avec des prix orientés à la hausse plutôt qu'à la baisse, mais cette corrélation se vérifie presqu'exclusivement durant la Grande dépression et autour de cette période.
Troisièmement, en approfondissant l'analyse des données, les auteurs montrent que les baisses de la production ont été plus marquées lors d'épisodes de recul soutenu des prix immobiliers, en particulier, que lors d'épisodes de baisse prolongée du prix des biens.
Enfin, jusqu'à présent, on ne trouve guère de données probantes étayant une association avec des spirales déflationnistes par la dette, durant lesquelles la baisse des prix accroîtrait la charge de la dette, qui à son tour, déprimerait l'activité économique.
Changeons maintenant de point de vue et passons à l'étude sur la liquidité de marché et la tenue de marché dans les marchés de titres à revenu fixe. S'appuyant sur le récent rapport d'un comité de banquiers centraux, mes collègues Ingo Fender et Ulf Lewrick se penchent sur les changements de conditions de liquidité de marché après la crise financière mondiale.
Les conditions de liquidité sont revenues à leur situation d'avant la crise sur les marchés de la dette souveraine, contrairement à d'autres segments du marché des titres à revenu fixe. Ainsi, par exemple, les marchés des obligations d'entreprise semblent moins liquides que par le passé. Les écarts de cotation sont presque revenus à leur niveau d'avant la crise, mais des doutes subsistent quant à la façon dont le marché réagirait à d'importantes transactions, en particulier si de nombreux opérateurs décidaient de céder des positions risquées au même moment.
De fortes variations de prix sur des marchés habituellement très profonds et très liquides se sont déjà produites. Pensons, notamment, au marché des bons du Trésor américain en octobre dernier et, plus récemment, aux brusques variations du franc suisse en janvier. Heureusement, aucun de ces évènements n'a eu de conséquences durables sur la stabilité financière, mais les marchés financiers ne sont pas toujours étanches, aussi faudra-t-il se montrer vigilants aux effets potentiels sur l'économie de perturbations qui les traverseraient.
L'étude consacrée à la relation entre pétrole et dette illustre les risques que je viens de relever. J'en suis l'un des co-auteurs, avec Dietrich Domanski, Jonathan Kearns et Marco Lombardi. Nous partons du constat que la dette du secteur pétrolier a été multipliée par deux et demi depuis 2006 pour s'établir à $2 500 milliards fin 2014.
Comme l'a montré le marché de l'immobilier durant la crise financière, lorsqu'un secteur de l'économie est fortement endetté, la baisse de la valeur sous-jacente de ses actifs peut provoquer des perturbations à court terme, qui amplifient tout choc initial.
Les taux de croissance de la production qui se maintiennent à un niveau élevé et la rapide accumulation de stocks de pétrole pourraient, en partie, s'expliquer par les besoins en trésorerie des producteurs de pétrole pour assurer le service de leur dette.
En particulier, nous montrons que les activités de couverture sont le signe d'une courbe d'offre à pente descendante, où la baisse des prix est associée à une augmentation des ventes de pétrole sur le marché des contrats à terme.
La liquidité de marché et la capacité des opérateurs à absorber les ventes déterminent dans quelle mesure le fait de vendre dans un marché orienté à la baisse provoque une amplification de l'effet sur les prix.
Une part de la récente chute des prix du pétrole pourrait être attribuée à la moindre capacité des courtiers en swaps à absorber les ventes. Sur cette dernière observation, nous nous retrouvons donc, de nouveau, sur le terrain de l'étude précédente, la liquidité de marché, et bouclons, pour ainsi dire, la boucle.